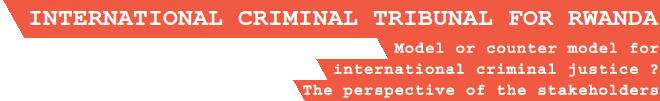Jean-Pierre GETTI
contribution 01 -
GETTI Jean-Pierre

version originale
Cet après-midi est donc consacré au premier thème de cette session : les poursuites. Si vous permettez, je vais tout d’abord me présenter parce que je suis ici un peu ému, impressionné par la qualité des intervenants et des personnes présentes. Je suis peut-être le seul ici à avoir eu à connaître le démarrage des deux juridictions internationales : le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal pour le Rwanda. Le contexte que je pu trouver à l’époque était certainement très différent de celui que vous avez pu connaître par la suite. D’ailleurs, si l’on en croit la longévité des procureurs telle qu’indiqué dans le document qui nous a été remis, les premiers ont certainement beaucoup investi parce qu’ils sont restés peu de temps. Ils ont dû être épuisé par la mise en place de la juridiction puisque Monsieur Goldstone est resté deux ans, Madame Arbour trois ans, Madame Del Ponte quatre ans, et Monsieur Jallow six ans. Je ne sais pas s’il y a un rapport entre les difficultés inhérentes à l’installation d’une juridiction et la longévité, mais toujours est-il que je peux témoigner de cette période extrêmement délicate de la mise en place des juridictions.
Pour ma part, je suis magistrat français. J’ai été pendant 15 ans à Paris juge d’instruction et plus particulièrement chargé des affaires de crimes contre l’humanité en rapport avec les événements de la dernière guerre. Lorsque le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a été créé, le Ministère de la justice m’a demandé si j’accepterais de participer aux travaux de cette juridiction. J’ai spontanément accepté d’y participer. C’est ainsi que je me suis retrouvé en 1994 à La Haye détaché à l’ONU avec la première équipe du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, sous l’égide du Procureur Goldstone, puisque c’était le premier Procureur. A ce moment-là, les prémices de Tribunal pénal international même pas encore. Je reviendrai sur cette période de démarrage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie parce que ça a aussi conditionné le démarrage difficile du Tribunal pénal international pour le Rwanda lorsque celui-ci a été constitué.
Je suis donc resté principalement en tant qu’adjoint du Procureur chargé des enquêtes au Tribunal pour l’ex-Yougoslavie jusqu’à juillet 1995. C’était la période des événements de Srebrenica. J’ai eu à superviser la première enquête à ce moment-là, notamment avec un policier que vous connaissez certainement très bien Madame Del Ponte, Monsieur Jean René Ruez, que j’avais eu à recruter à l’époque et qui a diligenté les premières enquêtes et qui, ensuite, les a poursuivies.
Ensuite, le Procureur voyant que se mettait en place la structure du Tribunal pénal international pour le Rwanda, il m’a prié d’aller au Rwanda pour faire une première évaluation de la situation sur place et de lui rendre compte de ce qu’il était envisageable de faire. La situation, à l’époque, c’était Kigali. Le bâtiment dans lequel était situé le Tribunal pénal international pour le Rwanda était un bâtiment en état plus que médiocre et c’était une ancienne antenne de l’UNICEF. Les conditions matérielles étaient donc extrêmement difficiles, mais aussi les conditions financières et humaines. Ce double démarrage sous l’égide du Procureur, Monsieur Goldstone, rendait extrêmement difficile l’installation matérielle et physique de ces deux juridictions : les équiper mais aussi recruter le personnel, les enquêteurs, les Juges, le Procureur. Cela faisait une masse de travail considérable. Dans ce contexte-là, avoir en plus à définir une politique pénale, c’était quelque chose d’extrêmement difficile. Une politique pénale à déterminer pour l’ex-Yougoslavie, mais aussi une politique pénale à déterminer pour le Rwanda.
En ce qui concerne le Tribunal pour le Rwanda, il a souffert manifestement d’un certain désintérêt, peut-être non voulu mais néanmoins manifeste en raison de cette absence de moyens qui existait à l’origine et qui a ralenti considérablement les premiers travaux et notamment les premières enquêtes. Ainsi, à l’époque, personne n’avait véritablement d’expérience non seulement dans une juridiction internationale mais en plus une ignorance totale de ce que pouvaient être les crimes dont ces juridictions étaient chargées : les crimes contre l’humanité, les génocides, les violations graves du droit humanitaire international. Pour des enquêteurs habitués à rendre en compte et à instruire des affaires criminelles classiques, c’était une découverte totale. De surcroît, ces enquêtes à l’origine devaient nécessairement s’intégrer tant dans l’ex-Yougoslavie qu’au Rwanda dans un contexte politique, social, voire ethnique, et religieux. Il fallait donc aussi intégrer toute cette dimension. Il n’y avait aucune préparation, aucune formation pour cela, ce qui a accru encore les difficultés de démarrage pour ces juridictions.
En ce qui concerne le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie, cette mise en place a été un peu rapide, les moyens étaient peut-être plus grands, plus facilement accordés. Monsieur Goldstone d’ailleurs s’est vivement démené pour obtenir des subventions de différents États, car il y avait une grosse pénurie financière de moyens matériels. Il fallait que, parallèlement, on puisse quand même donner matière à travailler aux Juges qui attendaient qu’on leur présente les premiers actes d’accusation et, a fortiori, les premiers accusés. Jusqu’au jour où l’Allemagne nous a livré le fameux Tadic qui n’était pas un personnage d’un très haut niveau et certainement quelqu’un de peu recommandable mais qui a permis, si vous permettez l’expression, de « roder les procédures ». D’ailleurs, à cette occasion, et peut-être à ses dépends, de nombreuses décisions et d’importantes décisions ont été rendues par la juridiction de La Haye.
Toutefois, cette arrestation de Monsieur Tadic, si elle était importante pour roder les procédures, a été peut-être, une erreur de départ dans la façon dont on avait conçu la politique pénale du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie. En effet, on cherchait bien entendu à atteindre les hauts responsables conformément au Statut qui avait été élaboré par l’ONU, et on avait Tadic sous la main. Tadic, un niveau inférieur à ce qu’on pouvait espérer conformément à ce Statut. Sur la base de cette première approche d’enquêtes s’est développée une stratégie de poursuite qui avait pour conception de rechercher la participation des exécutants et, ensuite, de remonter par degrés successifs à la tête selon une logique qui disait : « si la base est solide, on sera d’autant plus à l’aise pour atteindre les hauts responsables ».
Ce n’était pas forcément stupide, c’était solide, mais c’était complètement utopique. C’était complètement utopique parce que si on avait poursuivi dans cette voie-là, on serait encore en train d’instruire les éléments de base. Or, ce n’était pas la mission qui avait été confiée au Tribunal pénal international. C’est ainsi que lorsqu’on s’est rendu compte que la méthode que nous avions adoptée était erronée. Je me souviens très bien d’une réunion qui a eu lieu un soir dans le bureau du Procureur Goldstone au cours de laquelle les responsables des enquêtes, les juristes avaient exposé les difficultés que nous rencontrions. C’est à ce moment-là qu’a été complètement revue la politique de l’époque. Le Procureur nous a ordonné de fixer les objectifs conformément au Statut du Tribunal international, c’est-à-dire de viser les hauts responsables de crimes contre l’humanité ou le génocide et, ensuite, de rechercher les preuves pouvant les incriminer. En un mot de prendre le problème à l’envers. Je pense que c’était effectivement une bonne stratégie. Mais pour moi, c’est une autre histoire, parce qu’à ce moment-là, j’ai quitté le Tribunal international. Vous en savez donc plus que moi sur l’évolution de cette stratégie de départ des poursuites parce que moi, je n’ai pas eu l’honneur et la responsabilité de poursuivre dans cette voie-là.
Si je parle de cela, c’est parce que cette conception qui avait été à l’origine de la politique pénale du Tribunal international a aussi influé sur la conception de la politique pénale pour le Rwanda. Lorsque le Procureur m’avait prié d’aller faire une démarche là-bas, nous sortions de cette démarche erronée dans les poursuites. Il nous incombait à ce moment-là de définir les objectifs susceptibles d’être atteints au Rwanda toujours conformément au Statut. Ce n’était pas facile. La situation était extrêmement délicate là-bas, il y avait très peu de moyens, et élaborer une politique pénale claire, précise et cohérente dans un tel contexte était une véritable gageure.
Je reviens sur notre préoccupation de l’après-midi Que peut-on dire en définitive de ce que je relève à travers cette première expérience difficile même si elle était passionnante sur le plan judiciaire, car il s’agissait d’une mission de pionnier ? C’est la difficulté de définir une politique pénale, car engager des poursuites, c’est définir une politique pénale : qu’est-ce qu’on veut faire, quel objectif souhaite-t-on atteindre et par quels moyens ?
Alors, les objectifs. Les objectifs, je crois que ça correspond à ce que tout procureur dans n’importe quelle juridiction à travers le monde a en tête. C’est d’identifier les crimes, les auteurs et de faire le lien entre les crimes et les auteurs. C’est aussi une méthode, car il ne s’agit pas seulement d’identifier des crimes et d’identifier les auteurs, encore faut-il développer une méthode pour atteindre ces résultats. En ce qui concerne les crimes, je ne vais pas faire du droit maintenant, on est tous suffisamment au fait de ce qui existe, de ce qui est prévu dans les Statuts : les crimes contre l’humanité, génocide, violation du droit humanitaire international, tout le monde sait de quoi il retourne à ce sujet. En ce qui concerne les auteurs, les auteurs, comme il est dit dans le document qui nous a été remis (brochure de la conférence), ce sont les architectes du génocide. Alors qui sont-ils, ces architectes ? Est-ce que le rang, le niveau hiérarchique, que ce soit au niveau politique, civil ou militaire est suffisant ? Faut-il qu’il y ait une implication directe ? Par ailleurs, il y a un autre cas de figure concernant les auteurs : même si on n’a pas un rang hiérarchique élevé, on a pu commettre des crimes d’une ampleur particulière. Il n’y a pas forcément une relation entre niveau hiérarchique et les exécutants de crimes graves. Les deux peuvent se retrouver mais les deux peuvent être séparés également. Toujours concernant les auteurs, non seulement il faut les identifier mais encore faut-il établir le lien entre cet auteur et le crime qu’on lui impute. Donc tout ceci relève d’une démarche qui est complexe mais qui est dans l’habitude du Procureur lorsqu’il définit une politique pénale.
En ce qui concerne la méthode, c’est d’abord une parfaite cohérence entre les enquêteurs et le Procureur, car les deux sont intimement liés, surtout dans la façon dont sont constituées les poursuites par le statut de tribunal pénal international. Il y a bien sûr une très grande proximité entre les enquêteurs et le procureur, encore faut-il que les procureurs puissent donner les indications suffisamment claires et précises aux enquêteurs. Encore faut-il que les enquêteurs puissent restituer ce qu’ils ont trouvé comme preuve et savoir si celles-ci sont susceptibles de constituer des actes d’accusation présentables devant les juges. Cette méthode est donc quelque chose d’important à mettre en place. J’avais constaté, qu’il s’agisse à La Haye ou au Rwanda, au démarrage, qu’on avait affaire en général à des policiers d’excellente expérience professionnelle. Je me souviens avoir eu l’occasion de discuter avec bon nombre d’entres eux. Les parcours professionnels de ces enquêteurs étaient quelque chose d’absolument fantastique, ils avaient tous des histoires criminelles à raconter d’une complexité et d’une gravité qui donnaient l’assurance qu’ils avaient un grand professionnalisme.
Ceci est très important, mais la grande faiblesse, c’est ce qui a pêché au départ, c’est une absence de préparation, une absence de formation quant à la problématique locale. Cela a été quelque chose de difficile. Je me souviens m’être trouvé à Kigali et avoir vu arriver une équipe d’enquêteurs néerlandais qui avait été mis à disposition par le gouvernement néerlandais. Il y avait une vingtaine d’enquêteurs, des hommes extrêmement compétents. La question n’est pas là, je ne pourrais pas critiquer les enquêteurs néerlandais. Mais le gabarit légendaire était à peu près 1, 90 m et 90 kilos. Et lorsque ces 20 enquêteurs de ce gabarit ont débarqué dans les collines rwandaises, on a eu du mal à trouver des témoins et on a eu du mal à obtenir quelque résultat. C’étaient un peu les martiens qui débarquaient. Tout cela pour dire que cette absence de préparation malgré toute la bonne volonté qu’on pouvait avoir à l’époque a quand même posé quelques difficultés, vous en conviendrez. Ils étaient avec leur ordinateur portable, sachant que dans les collines il n’y avait pas d’électricité, donc cela posait un autre problème pour traduire les procès-verbaux.
Il y a un dernier point dans la méthode. Une politique pénale ne doit pas, notamment dans le cadre d’une juridiction internationale, simplement se limiter au domaine de la juridiction internationale. Mais on y reviendra peut-être plus tard. C’est aussi une coordination, voire une coopération avec d’autres États, notamment le Rwanda, bien entendu, mais aussi avec les États voisins africains, voire les États européens, américains ou d’autres qui auraient pu à la fois fournir des éléments de preuve voire fournir des auteurs de crimes. Une stratégie de politique pénale doit intégrer tout cela.
Les moyens, c’est la deuxième condition d’une politique pénale. Bien sûr, les moyens traditionnels, financiers, humains, matériels, tout le monde sait ce qu’il en est à ce sujet, je n’y reviens pas. Les moyens juridiques sont des moyens essentiels. Le Statut et le Règlement de procédure en la matière sont toujours les bases de l’action des enquêteurs et du Procureur. De ce côté-là, il n’y a pas de grosse difficulté. Par contre, il y a une grosse lacune dans les moyens juridiques, c’est l’absence de police internationale. Je crois que ce côté-là, tous les procureurs successifs l’auront souligné. On l’a constaté dès le démarrage. Sans une police qui dépendait de la juridiction, on ne pouvait compter que sur la bonne volonté des États pour obtenir, dès l’exécution de commissions rogatoires, l’arrestation de certains individus. C’est un énorme handicap de ne pas avoir la capacité de pouvoir exécuter directement les missions qui incombent à la juridiction internationale et notamment sous la responsabilité du Procureur. Interpole pouvant bien sûr pallier en partie à ces difficultés mais pas complètement.
Dernier point, et c’est une réflexion que j’ai lue dans les notes de Madame Del Ponte, c’est la dépendance du Procureur. C’est ce que j’appelle les moyens moraux. Comment assurer une politique pénale totalement indépendante sans être soumis au dictat de je ne sais quel État, sous la pression de je ne sais quelle organisation internationale, y compris l’ONU, sans entrer dans les considérations diplomatiques ou les tractations en vue de la paix ou d’une paix éventuelle ? C’est quelque chose auquel il faut effectivement réfléchir pour définir une politique pénale judiciaire totalement indépendante, parce que seule l’indépendance peut rendre crédible cette politique pénale. À ce sujet, je me permettrais de rappeler ce que, personnellement, j’ai vécu aussi à l’époque à La Haye pour l’ex-Yougoslavie. Au démarrage du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, il y avait le processus de paix. Le processus de paix, c’est un processus qui était enclenché déjà depuis plusieurs années et qui n’aboutissait pas. Il était sous la responsabilité du représentant du Secrétaire général d’origine japonaise qui avait manifestement de très grandes difficultés à aboutir dans cette démarche. On nous avait fait comprendre au TPIY qu’il ne fallait pas que l’on diligente trop rapidement des actes d’accusation ou qu’on délivre des mandats d’arrêt car c’était susceptible de contrecarrer le processus de paix.
Là encore, je me souviens d’une discussion que nous avons eue avec le Procureur Goldstone où cette question avait été soulevée. Il a été clairement édicté que les diplomates s’occupaient de la diplomatie et que les juges s’occupaient de la justice, et que chacun devait faire son travail. Par conséquent, quelles que soient les conséquences que les décisions des juges pouvaient avoir sur la diplomatie ou la politique, ce n’était pas l’affaire de la juridiction internationale. C’était aux diplomates de s’adapter aux circonstances et aux nécessités du moment en fonction des décisions judiciaires qui auraient pu être prises. Force est de constater que dès que nous avions adopté clairement cette position et que nous l’avons fait connaître, le processus de paix s’est accéléré pour aboutir en 1995 à des accords. Je ne sais pas s’il y a une corrélation immédiate, directe, mais j’ose le croire.
Alors, vous comprenez bien que dans un tel contexte, définir une politique pénale, ce n’est pas facile. J’ai pu constater en suivant les travaux du Tribunal pénal international, que ce soit pour l’ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda, qu’il y avait eu des orientations différentes. Celle de Madame Arbour, par exemple : on a appris qu’elle avait développé la théorie de l’entente avec une politique pénale qui avait pour objet de joindre les actes d’accusation et qui ne visait que les personnes en position d’autorité au moment du génocide. Un peu plus tard, peut-être sous l’égide de Madame Del Ponte, il y a eu le développement des enquêtes spéciales qui étaient chargées de conduire des investigations sur des faits spécifiques du FPR, APR. Voilà d’autres orientations possibles dans la politique pénale. À quoi a correspondu ces nouvelles orientations ? Quelle est la stratégie qui pouvait exister lorsqu’elles ont été adoptées ? Je pense que cela fait partie des questions que nous avons à nous poser cet après-midi. Voilà ce que je voulais indiquer en introduction.
Un dernier point, peut-être qui fera l’objet de discussions : une politique d’une juridiction internationale ne s’arrête pas brutalement un jour. Il y a un après. Cet « après », c’est lorsque le Tribunal pour le Rwanda fermera ses portes. Alors, je ne sais pas quand exactement, parce que je n’ai pas d’indication précise sur cet aspect, vous en savez peut-être mieux que moi à ce sujet. Mais ce n’est pas pour autant que tout est solutionné, tout est réglé. Là encore une politique pénale cohérente, juste et efficace ne peut se faire qu’en collaboration, coopération avec ceux qui auront à reprendre chez eux, selon leur propre mode de gestion de la justice, la suite de cette juridiction internationale.
Voilà ce que je souhaitais indiquer comme élément d’ouverture cet après-midi. À ce titre, certains d’entre vous ont adressé des intentions d’intervention sur une ou plusieurs des questions déjà évoquées, et sur d’autres. Je n’ai pas la prétention d’avoir balayé tous les points sur les poursuites. Il y a encore de très nombreuses questions qui peuvent se poser, néanmoins il faut lancer les débats.
Je propose que Monsieur Stewart, qui a fait une fiche assez détaillée sur les poursuites en abordant un certain nombre de questions, prenne la parole.